Que recherchez-vous ?
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
GATTI (L.), LAUBA (A.), Etudes et recherches sanitaires et médico-sociales. Cahiers François Citoys, Poitiers, PUJP, 2025 (n°1)
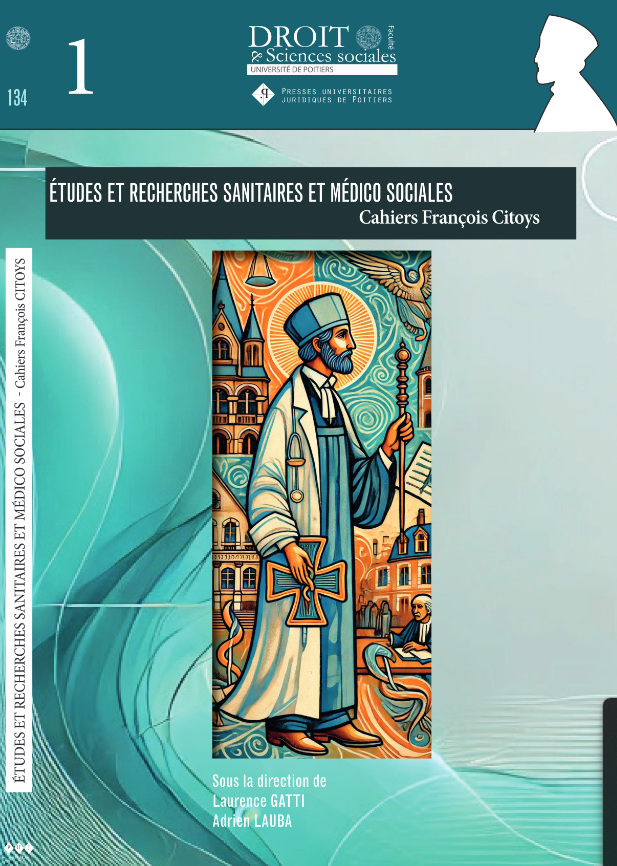
Table des matières
– Gérard MÉMETEAU Littérature et droit médical – Avant-propos
– Anne-Catherine NADAUD Littérature et médecine – Anthologie d’une dilettante
– Adrien LAUBA « Mangeurs de médicaments » et écrivains perdus dans les paradis artificiels. De quelques Dippers de la Littérature française en marge des bonnes mœurs… (XIX-XXe siècles)
– Gérard MEMETEAU Balzac et Jules Romains : cession de cabinet médical
– Michel SAPANET Petites histoires de légiste au regard du droit médical
– Quentin LE PLUARD Tempête dans un clystère : déontologie médicale et figure du médecin chez Molière
– Lucie PORTRON À propos de l’ouvrage de Florence Nightingale : des soins à donner aux malades : ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter
– Laurie FRIANT Ce que la littérature dit du droit médical. L’exemple des violences gynécologiques et obstétricales
-Christian BYK Le pied-bot d’Hippolyte : une leçon à tirer pour comprendre ce que dit le droit médical des moeurs contemporaines
– Camille BOURDAIRE-MIGNOT et Tatiana GRÜNDLER Vieillir et mourir, un exercice de style ? Variations autour du droit de la fin de vie. À propos de Lionel Shriver « À prendre ou à laisser » (Belfond, 2023, 284 p.)
– Quentin LE PLUARD Horresco referens ! Droit médical et recherche dans une nouvelle d’H. P. Lovecraft « Herbert West, Réanimateur » (1921-1922) ou le dévoiement de la curiosité médicale
– Quentin LE PLUARD Les fins du droit médical dans la littérature de science-fiction En finir et définir
– Franck LECLÈRE et Nematollah JAAFARI La réunion de concertation pluridisciplinaire : définition juridique et application à la prise en charge de la dysphorie du genre
Le présent ouvrage entend combattre plusieurs idées reçues qui dominent deux points en réalité connexes. Les unes touchent à la guerre franco-thaïlandaise de 1940-1941 dont l’interprétation est faussée par une représentation partielle et partiale, tant en France qu’à l’étranger. Les travaux hexagonaux ont trop longtemps véhiculé la thèse d’une collusion siamo-japonaise qui est tardive et biaisée à la fois. De leur côté, les historiographies anglo-saxonnes et asiatiques sont encore largement déterminées par toute une série d’allégations dont le fondement se trouve dans la documentation thaïlandaise et dans les sources américaines postérieures à 1945, à l’heure où la guerre froide commandait de réhabiliter un pays compromis avec le Japon mais entré depuis dans la sphère d’influence de Washington : elles sont partisanes.

Or, en exploitant des fonds trop peu explorés et en les confrontant aux acquis les plus récents de la recherche, une nouvelle histoire se dessine, bien plus complexe. Le constat peut être étendu au régime juridique du Laos, volontiers décrit aujourd’hui encore comme un protectorat dont la naissance remonterait à Auguste Pavie et à l’installation des Français sur la rive gauche du Mékong. Rien n’est moins vrai. Il faut en effet attendre le traité du 29 août 1941, conséquence immédiate de la guerre avec la Thaïlande, pour que soit enfin établi le tout premier protectorat de la région, celui qui s’exerce sur le royaume de Luang Prabang, duquel sortira, après les péripéties consécutives au coup de force japonais de mars 1945, le Laos moderne, fruit de la loyauté et de la ténacité de Sisavang Vong.
La faillite de la règle est ancienne. Sous l’Ancien Régime, bien souvent les lois ne s’imposent que sur un mode facultatif et constituent un instrument défaillant du pouvoir monarchique. Certaines demeurent à l’état de voeu pieux, d’autres peinent à être appliquées, sont laissées en « souffrance », quand elles ne sont pas totalement enfreintes par les gouvernés ou ceux chargés de les faire respecter. Bien qu’elle oblige, la loi est l’objet de perpétuelles transgressions, soit qu’on l’ignore, qu’on la rejette, qu’on la déforme, qu’on la contourne. C’est sous cet angle que les différentes contributions à cet ouvrage abordent l’histoire de la loi à l’époque moderne. Toutes nourrissent ce constat : il existe une désobéissance à la loi propre à la modernité. Celle-ci se signale notamment par son caractère généralisé, la variété de ses formes, les multiples raisons avancées pour la justifier, mais aussi par la réponse très mesurée que lui apporte le pouvoir. Dès lors, la désobéissance dont il est ici question est « à géométrie variable », « par action », « volontaire », « évitée », « pardonnable », « légitime » ou encore « revisitée », illustrant par-là les « paradoxes inhérents à la construction de l’État moderne et au déploiement de la souveraineté monarchique » (A. Rousselet-Pimont, dans la préface).
Le présent ouvrage dirigé par Damien Salles (Institut d’Histoire du droit de l’Université de Poitiers) réunit les travaux de douze contributeurs : A. Rousselet-Pimont (Professeur d’Histoire du droit à l’École de Droit de la Sorbonne), Laurent Bouchard (Maître de conférences HDR en Histoire du droit à l’Université de Poitiers), Paul Chauvin Madeira (Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université de Tours), Alexandre Deroche (Professeur d’Histoire du droit à l’Université de Tours), Marta Peguera (Professeur d’Histoire du droit à l’Université de Lorraine), Sébastien Le Gal (Professeur d’Histoire du droit à l’Université Grenoble-Alpes), Charles Baud, Docteur en Histoire du Droit de l’Université Paris II-Panthéon-Assas, Archiviste paléographe, ancien élève de l’École des Chartes), Fabrice Desnos (Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université de Rouen), Éric Gojosso (Professeur d’Histoire du droit à l’Université de Poitiers), Cédric Glineur (Professeur d’Histoire du droit à l’Université d’Artois), Damien Salles (Professeur d’Histoire du droit à l’Université de Poitiers) et Thomas Boullu (Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université de Strasbourg).
Du 27 juin au 1er juillet 2022, la 7ème Université d’été Facultatis Iuris Pictaviensis de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, consacrée au Poison, a été l’occasion de revenir, sur une thématique d’une brulante actualité (pandémie, scandales sanitaires, légalisation du cannabis, autorisation de la vente du CBD, utilisation d’armes chimiques…).
Le présent ouvrage n’a pas pour prétention de traiter de l’ensemble de la question. Il n’est en réalité que la retranscription des conférences qui se sont alors succédées. Ce sont ainsi 25 articles, relevant de plusieurs spécialités (Droit, Histoire, Philosophie, Psychologie…), qui sont aujourd’hui publiés en 4 chapitres : Des histoires de poison, Le poison dans tous ses états, Les poisons culturels, Le poison sous contrôle (?).
Initialement prévue du 27 au 31 juillet 2020, la sixième édition de l’Université d’été facultatis iuris Pictaviensis de la Faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers a dû être reportée en raison des circonstances sanitaires, puis reprogrammée sur une journée. C’est ainsi que le 25 juin 2021, ont été retransmises, en webinaire, des « Conférences d’été », lesquelles ont réuni 7 conférenciers qui ont pu rendre compte de leurs travaux sur La Mort, ses aspects juridiques et extra-juridiques.
Malgré les circonstances, le succès de cette édition ne s’est pas démenti. Composé d’étudiants et de doctorants français et étrangers, de professionnels et d’enseignants-chercheurs le public était en effet nombreux.
Le présent ouvrage correspond à une version plus ambitieuse que la retranscription de ces 7 seules communications. Ce sont donc au total près de 15 articles relevant de plusieurs spécialités (Droit, Histoire de l’Art, Philosophie
) qui sont présentés en 3 chapitres successifs : Les limites de la mort, Les figures de la mort et Le corps des morts. La conclusion doit être appréhendée comme une ouverture sur « l’Au-delà ».
Malgré le succès actuel du courant Droit et Littérature, il n’existait jusqu’alors aucune étude d’ensemble consacrée au droit administratif. C’est ce manque que cet ouvrage entend en partie combler. Ce regard littéraire sur la discipline n’est pas un exercice d’érudition dénué de toute portée. Le décloisonnement des savoirs et l’alliance des compétences de juristes, d’historiens et de lettrés, apportent une authentique contribution à la connaissance de la pensée juridique. Trois thématiques nourrissent cette approche critique des racines du droit administratif : les grands auteurs, les grands récits et les grands procédés littéraires.
L’ouvrage explore ainsi les valeurs et les fonctions que la doctrine administrativiste a en vue lorsqu’elle distingue en son sein un corpus spécifique d’auteurs. Il met en outre en lumière des administrativistes qui se sont illustrés par une double vie (juridique et littéraire) et s’enquiert de l’influence de cette incursion dans les lettres sur leur présentation du droit administratif. Il s’empare encore de la puissance instituante des récits du droit administratif et de ceux mettant en scène l’administration afin de rechercher leur sens et leur rôle. Enfin, par ses réflexions et analyses historiques sur les mots, le style, les adages, les métaphores, les genres qui impriment leur marque dans l’écriture du droit administratif, il restaure la littérarité trop longtemps dissimulée de cette discipline.
Découvrez l’interview d’Anne-Laure Girard, Adrien Lauba et Damien Salles en cliquant ici
Présentation par l’éditeur :
Ce manuel d’Introduction historique au droit et d’Histoire des institutions couvre plus spécialement l’intégralité du programme d’histoire de la 1re année de licence en droit. Il développe l’histoire du pouvoir et de l’administration d’une part, celle du droit et de la justice d’autre part, à travers les grandes périodes de l’histoire de France, depuis l’époque franque jusqu’aux débuts de l’époque contemporaine.
Illustré par de nombreux cas pratiques et ponctué de conseils méthodologiques, cet ouvrage vise à rendre accessible au plus grand nombre les connaissances nécessaires en histoire du droit.
Du 1er au 5 juillet 2019, la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers a organisé la cinquième édition de son Université d’été facultatis iuris Pictaviensis. Sur le thème « Les Animaux » celle-ci a réuni un public nombreux composé d’étudiants et de doctorants français et étrangers, de professionnels et d’enseignants-chercheurs. Plusieurs intervenants de divers pays et spécialités (droit, littérature, philosophie, sociologie et biologie) ont rendu compte, de façon didactique et pédagogique, de leurs travaux. Ceux-ci sont aujourd’hui réunis, pour une grande partie d’entre eux, dans le présent ouvrage et répartis dans 6 chapitres successifs : Les animaux, statut et place dans la société humaine, Les animaux, sujets de causes, Les animaux, variations techniques, La protection des animaux, Les animaux dans le monde et Les animaux, entre nuisance et utilité.
Du 2 au 6 juillet 2018, la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers a organisé la quatrième édition de son Université d’été facultatis iuris Pictaviensis. Sur le thème de « l’ordre public », plusieurs intervenants de toutes les équipes de recherche ont présenté de façon didactique et pédagogique le fruit de leur réflexion sur de nombreuses problématiques posées par cette question ô combien intéressante.
Celles-ci se sont articulées autour de 7 axes confrontant la notion, notamment, à l’écologie, au droit rural, au droit civil, au droit administratif, au droit du cinéma et de l’audiovisuel, au droit pénal, aux droits international et européen et au droit du travail.
Le public était composé d’étudiants et de doctorants français et étrangers, de professionnels et d’enseignants-chercheurs. Le présent ouvrage reprend une partie des conférences entendues au cours de cette quatrième édition de l’Université d’été.
Dans le cadre d’un programme de collaboration scientifique avec la Faculté de droit de l’Université de Cambridge et avec le soutien de l’Institut d’histoire du droit de Poitiers, le site http://www.copyrighthistory.org/ permet un accès gratuit aux sources essentielles de l’histoire de la propriété intellectuelle, non seulement pour la France et l’Angleterre, mais encore pour les premiers privilèges italiens, l’Allemagne et les Etats-Unis.
Le projet remonte à 1996 et s’inscrit dans une démarche comparatiste de l’histoire de la propriété intellectuelle.
Celle-ci met notamment en lumière que la convergence de certains débats français et anglais du XVIIIe siècle est frappante. C’est par exemple le cas de la spécificité du travail de l’auteur, de la qualification du droit d’auteur en termes de propriété, de la distinction œuvre-invention ou de la formulation du caractère libre de l’idée.
Mis en ligne depuis mars 2008 à l’occasion d’un colloque international à la Stationer’s Company, le site est en perpétuel développement, s’enrichissant sans cesse de nouveaux articles et de nouvelles sources. Il est en outre probable qu’il s’étendra prochainement aux juridictions d’autres pays.
BOUDOT (M), VECCHI (PM), VEILLON (D), Promesses et actes unilatéraux. Actes des 7èmes journées d’études Poitiers-Roma III (12 et 13 juin 2009) co-organisées par les équipes d’histoire du droit et de droit privé, Paris, LGDJ, 2011
GOJOSSO (E.), Le contrôle de constitutionnalité des lois dans la France de l’Ancien Régime. Bilan historiographique, Budapest, Rechtsgeschichtliche Vorträge Lectures sur l’histoire juridique, 2010, n°61 (Publication du groupe de recherche pour l’histoire juridique de l’Académie hongroise des Sciences et de la Chaire d’histoire du droit hongrois de l’Université Eötvös Lorand Budapest)
FRÊLON ALLONNEAU (E.), Le Parlement de Bordeaux et la « loi » (1451-1547), Paris, De Boccard, 2011 :
Érigé par Charles VII au lendemain de la reconquête du duché de Guyenne, le Parlement de Bordeaux est le troisième au royaume de France après ceux de Paris et de Toulouse. D’étroits rapports unissent aussitôt le monarque à ses officiers pour une collaboration qui dure au moins jusqu’au règne d’Henri II. Juges avant tout, ces hauts magistrats s’imposent aussi comme de solides administrateurs tout au long de la période 1451-1547, ce qui les place dans une situation souvent ambiguë par rapport à la « loi ».
Dépositaires comme tous les parlementaires du royaume du pouvoir d’appliquer la norme royale, ils s’en font un devoir. En même temps, très sensibles comme leurs collègues parisiens au principe de gouvernement par conseil, présidents et conseillers bordelais attachent grand prix à participer à l’élaboration de la norme royale dont ils deviennent en partie les auteurs. Soit que le monarque les sollicite directement, soit qu’il accède à leurs remontrances ordinaires ou à leurs requêtes. Ils en sont également les correcteurs, par le biais de remontrances d’une autre nature et par le jeu subtil des modifications qu’ils parviennent souvent à imposer au pouvoir. Enfin, pour venir au secours du prince dans le ressort de son parlement, ou pour répondre dans l’urgence aux attentes pressantes de leurs justiciables, ils assument volontiers la fonction de législateur provincial.
En dépit de cette volonté affirmée d’autonomie normative et de gestion directe des affaires provinciales, les magistrats du parlement de Guyenne ne se départissent jamais de leur fonction cardinale de gardiens de la « loi ». Aussi bien que toute autre parlement, ils savent conserver soigneusement les lettres royaux qu’ils ne se limitent pas à sèchement archiver. Avant leur enregistrement, ils les soumettent à une minutieuse vérification de forme et de fond. Puis vient le temps de leur publication, opération dont le succès est gage d’une application réussie, comme il l’est aussi pour les normes qu’ils édictent en direction de la province et qu’ils portent, dans des conditions similaires, à la connaissance de leurs justiciables. Si bien que distinguer les prescriptions du roi de celles de ses représentants devient chaque jour plus difficile en raison de l’affirmation toujours plus vive d’un pouvoir règlementaire autonome du parlement bordelais.
RIDEAU (F.), «Nineteenth Century Controversies Relating to the Protection of Artistic Property in France», in. DEAZLEY (R.), KRETSCHMER (M.), BENTLY (L.) (ed.), Privilege and Property Essays on the History of Copyright, Cambridge, Openbook Publishers, 2010, pp. 241-254
Nineteenth century controversies relating to the protection of artistic property in France